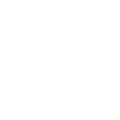MSD Connect, la communauté des professionnels de santé à la recherche d’une information scientifique fiable au service de leur pratique et de leurs patients.
Vous n’êtes pas un professionnel de santé ? Visitez notre site institutionnel !
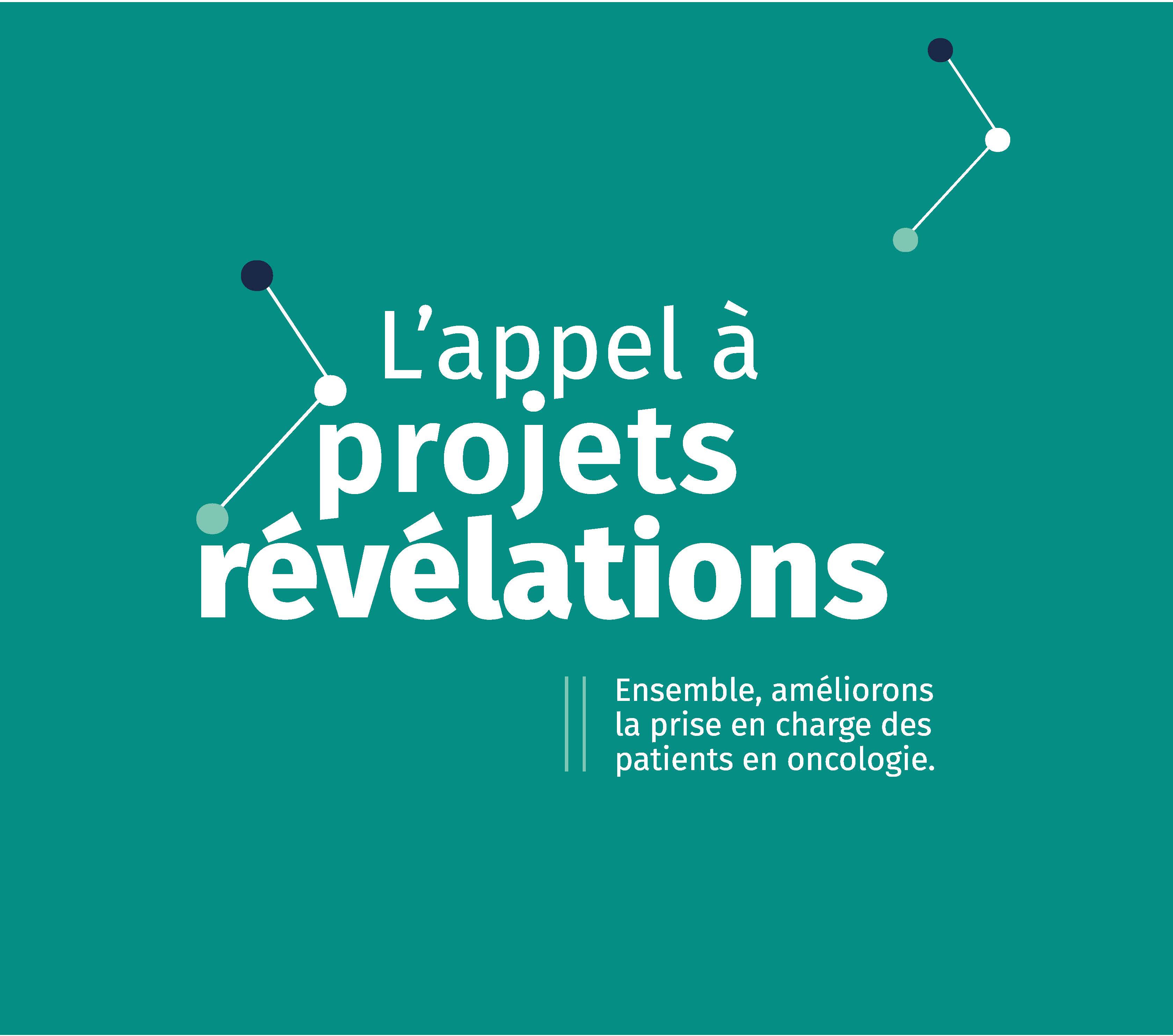
L’Appel à projets révélations
Le laboratoire MSD lance l’appel à projets révélations pour soutenir et récompenser des projets et des initiatives innovantes en oncologie sur l’amélioration du parcours de soins et de l’expérience patient en Immuno-Oncologie et Oncologie au travers de 3 thématiques : Les soins de supports non médicamenteux, la pharmacie clinique, et les données de santé.
À la une
Retrouvez les dernières actualités destinées aux professionnels de santé sur nos différentes expertises médicales : recommandations, cas cliniques, référentiels, quizz et test de connaissances pour chaque aire thérapeutique.

L’innovation technologique médicale au service de la santé
La MedTech (Medical Technology) est un secteur innovant qui met le progrès technologique au service de la santé pour inventer la médecine de demain et ainsi améliorer la qualité de vie des patients. Aujourd’hui, plus de 500 000 produits issus de la technologie médicale ont été mis à la disposition des hôpitaux, des établissements de soins et de nombreux foyers à travers le monde entier.

Les progrès attendus en médecine régénérative
La médecine régénérative est une des approches thérapeutiques les plus prometteuses du 21e siècle et porteuse d’espoirs. Découvrez notre article !

La vaccination contre les rotavirus face a la diversité des souches
En France, plusieurs souches circulent et sont responsables chaque année d’une épidémie de gastro-entérites aiguës notamment chez les nourrissons et les jeunes enfants. Deux vaccins pour la prévention des gastro-entérites à rotavirus sont disponibles en France à ce jour, et ce depuis leur autorisation de mise sur le marché délivrée en 2006.
Evénements digitaux
Rejoignez notre communauté d’experts santé et venez vivre l’expérience exclusive des webinars MSD Connect en live ou en replay.
Services et ressources
Accédez directement aux services et ressources mis à votre disposition par MSD pour vous accompagner dans votre pratique au quotidien et la prise en charge de vos patients : disponibilité des stocks sur les médicaments et vaccins MSD, guides pratiques et protocoles, rupture de la chaîne du froid…
En savoir plus sur les domaines d’expertise MSD
Pour chaque expertise médicale, nous avons centralisé l’ensemble des dernières actualités et recherches pour faciliter votre quotidien et l’accompagnement de vos patients : des contenus fiables et vérifiés pour vous accompagner dans votre pratique et avec vos patients.